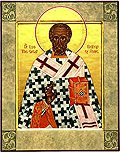Essayer de comprendre comment les Grecs voyaient les Enfers conduit, tout à fait logiquement, à comprendre comment ils percevaient la mort et la vie même. Cette vision n’a cependant rien d’immuable et de dogmatique : au fil du temps, la perception de la mort et des Enfers a évolué jusqu’à acquérir, à l’époque platonicienne, l’idée d’un jugement en fonction de l’honnêteté de la vie. Une vision, au final, assez proche de celle des chrétiens donc.
A l’origine, cependant, du moins à l’époque homérique, les Enfers ne font qu’un ; on peut alors parler de l’Enfer. C’est l’Erèbe, littéralement l’Obscurité, qui est une sorte de lieu sombre et brumeux où réside tous les morts, sans distinction et quel qu’ait été leur vie ; un lieu dont on ne s’échappe pas et d’où procède toute vie.
Certes, le Tartare existe déjà chez Homère mais il n’a en fait rien à voir avec les Enfers : il n’est pas soumis à Hadès et sert de prison aux dieux réprouvés et aux héros bannis. Le commun, quant à lui, se regroupe indistinctement dans les profondeurs de la Terre. L’inhumation explique cette croyance et l’idée du retour à la Terre-mère, la Terre nourricière explique la pratique. Le religion grecque archaïque ressemble en cela à toutes les mythologies indo-européennes originelles qui ont une perception cyclique de la vie… et donc de la mort.
Les Enfers sont donc souterrains. Et le séjour des morts, s’il n’a rien de particulièrement violent, se résout à une existence pâle, décolorée, sans consistance. Sans corps, bien sûr, sans force, les âmes des morts errent sans but, ayant perdu jusqu’à leur conscience. La mort est alors une véritable mort de l’âme en même temps que du corps. Ombres du défunt, elles n’ont conservé que l’apparence du corps, et sont impalpables, échappant à l’étreinte des vivants. Comparées à une fumée, à un songe, les âmes des morts n’ont plus de voix et ne produisent qu’un sifflement. Pourquoi voudraient-elles parler, d’ailleurs, n’ayant plus ni sentiment ni conscience… Le fait qu’Homère compare les âmes défuntes aux songes n’est pas anodin : les divinités chtoniennes ou leurs monstres peuplent fréquemment les rêves, annonçant la mort. C’est d’ailleurs aussi le cas des fées médiévales, comme Mélusine, qui sont annonciatrices ou vecteurs de mort…
A l’origine, cependant, du moins à l’époque homérique, les Enfers ne font qu’un ; on peut alors parler de l’Enfer. C’est l’Erèbe, littéralement l’Obscurité, qui est une sorte de lieu sombre et brumeux où réside tous les morts, sans distinction et quel qu’ait été leur vie ; un lieu dont on ne s’échappe pas et d’où procède toute vie.
Certes, le Tartare existe déjà chez Homère mais il n’a en fait rien à voir avec les Enfers : il n’est pas soumis à Hadès et sert de prison aux dieux réprouvés et aux héros bannis. Le commun, quant à lui, se regroupe indistinctement dans les profondeurs de la Terre. L’inhumation explique cette croyance et l’idée du retour à la Terre-mère, la Terre nourricière explique la pratique. Le religion grecque archaïque ressemble en cela à toutes les mythologies indo-européennes originelles qui ont une perception cyclique de la vie… et donc de la mort.
Les Enfers sont donc souterrains. Et le séjour des morts, s’il n’a rien de particulièrement violent, se résout à une existence pâle, décolorée, sans consistance. Sans corps, bien sûr, sans force, les âmes des morts errent sans but, ayant perdu jusqu’à leur conscience. La mort est alors une véritable mort de l’âme en même temps que du corps. Ombres du défunt, elles n’ont conservé que l’apparence du corps, et sont impalpables, échappant à l’étreinte des vivants. Comparées à une fumée, à un songe, les âmes des morts n’ont plus de voix et ne produisent qu’un sifflement. Pourquoi voudraient-elles parler, d’ailleurs, n’ayant plus ni sentiment ni conscience… Le fait qu’Homère compare les âmes défuntes aux songes n’est pas anodin : les divinités chtoniennes ou leurs monstres peuplent fréquemment les rêves, annonçant la mort. C’est d’ailleurs aussi le cas des fées médiévales, comme Mélusine, qui sont annonciatrices ou vecteurs de mort…
Le conception homérique des Enfers perdurera jusqu’à la fin du VIIe siècle. L’apparition de l’orphisme -et d’autres cultes à mystères comme le culte dionysiaque ou éleusien- ne bouleverse pas uniquement la théogonie traditionnelle mais également la vision des Enfers. L’âme devient alors immortelle, une idée qui, si elle n’est pas niée par Homère, n’est nullement affirmée. L’orphisme, au contraire, en fait un socle, comme il affirme la supériorité de l’âme sur le corps qui devient « le tombeau de l’âme ». Le but est alors de s’affranchir de ce corps, ce qui n’a rien d’évident car, selon la mythologie orphique, l’âme a fauté, ce qui explique que l’âme soit prisonnière d’un corps –humain ou animal. L’orphisme seul permet de sortir de ce cercle immuable, un cercle né à la suite d’une faute commise par l’homme-âme et qui le bannit définitivement du monde des dieux. Quelle est cette faute ? Les textes ne sont guère explicites mais il paraît difficile de ne pas faire un parallèle avec le péché originel rapporté par la Bible.
La conception orphique de la mort et des Enfers implique également l’idée d’un jugement de l’âme. Prononcé par Hadès ou Perséphone, ce jugement dépend avant tout de l’implication du mort dans les mystères orphiques. Les profanes n’ont droit qu’aux ténèbres et à la boue et sont même condamnés à puiser sans cesse de l’eau. Le supplice de Tantale n’est pas loin… Quant aux criminels, ils sont rejetés au fond du Tartare où ils subissent les pires tourments. Déjà, donc, le Tartare n’est plus réservé aux seuls dieux. Et ce n’est pas le seul lieu qu’ils doivent partager : les initiés de l’orphisme sont accueillis dans l’Elysée souterrain, la demeure des êtres purs et des dieux. Puis, lorsqu’ils ont enfin achevé le cycle de leurs réincarnation, c’est, selon Pindare, la félicité suprême qui les attend dans les îles Fortunées. Heureux les adeptes de l’orphisme et ceux des mystères dionysiaques et éleusiens ; heureux les initiés qui sont « purs », « saints », quant le profane paye, de toute façon, son incroyance. Malgré tout, il faut voir dans ces religions à mystères l’apparition d’une croyance en une sanction morale selon la vie du défunt. Une sanction qui apparaît très clairement à l’époque classique. Mais alors les juges des Enfers ne sont plus Hadès ou Perséphone mais Zeus ou, dans l’Apologie de Platon, ses fils : Minos, Rhadamante et Hermès. Un dépossession complète du rôle d’Hadès en faveur de Zeus qui ressemble presque à une « monothéisation »…
La conception orphique de la mort et des Enfers implique également l’idée d’un jugement de l’âme. Prononcé par Hadès ou Perséphone, ce jugement dépend avant tout de l’implication du mort dans les mystères orphiques. Les profanes n’ont droit qu’aux ténèbres et à la boue et sont même condamnés à puiser sans cesse de l’eau. Le supplice de Tantale n’est pas loin… Quant aux criminels, ils sont rejetés au fond du Tartare où ils subissent les pires tourments. Déjà, donc, le Tartare n’est plus réservé aux seuls dieux. Et ce n’est pas le seul lieu qu’ils doivent partager : les initiés de l’orphisme sont accueillis dans l’Elysée souterrain, la demeure des êtres purs et des dieux. Puis, lorsqu’ils ont enfin achevé le cycle de leurs réincarnation, c’est, selon Pindare, la félicité suprême qui les attend dans les îles Fortunées. Heureux les adeptes de l’orphisme et ceux des mystères dionysiaques et éleusiens ; heureux les initiés qui sont « purs », « saints », quant le profane paye, de toute façon, son incroyance. Malgré tout, il faut voir dans ces religions à mystères l’apparition d’une croyance en une sanction morale selon la vie du défunt. Une sanction qui apparaît très clairement à l’époque classique. Mais alors les juges des Enfers ne sont plus Hadès ou Perséphone mais Zeus ou, dans l’Apologie de Platon, ses fils : Minos, Rhadamante et Hermès. Un dépossession complète du rôle d’Hadès en faveur de Zeus qui ressemble presque à une « monothéisation »…